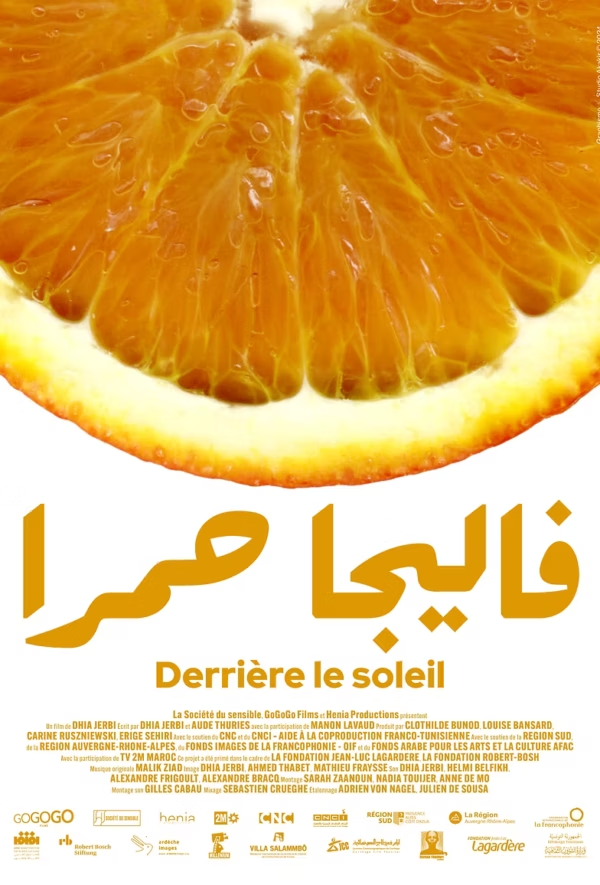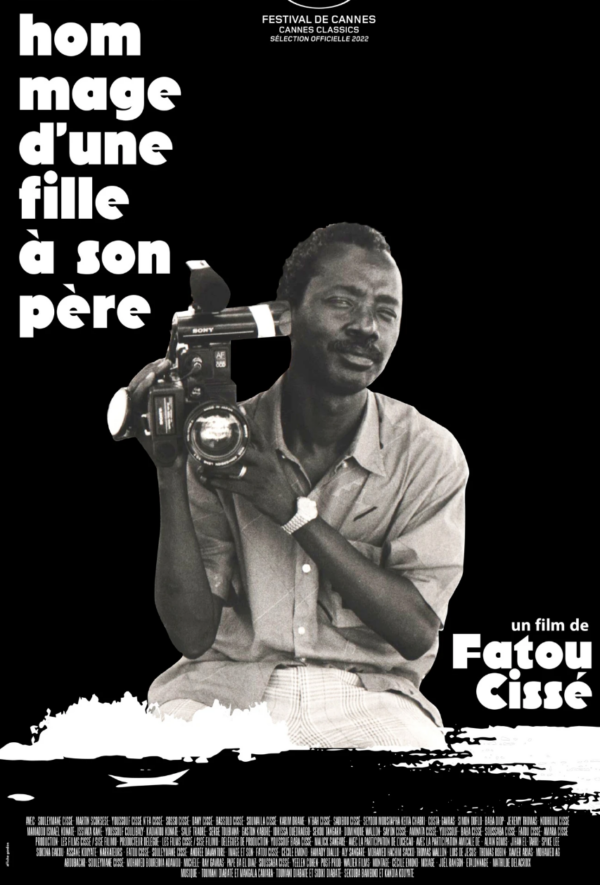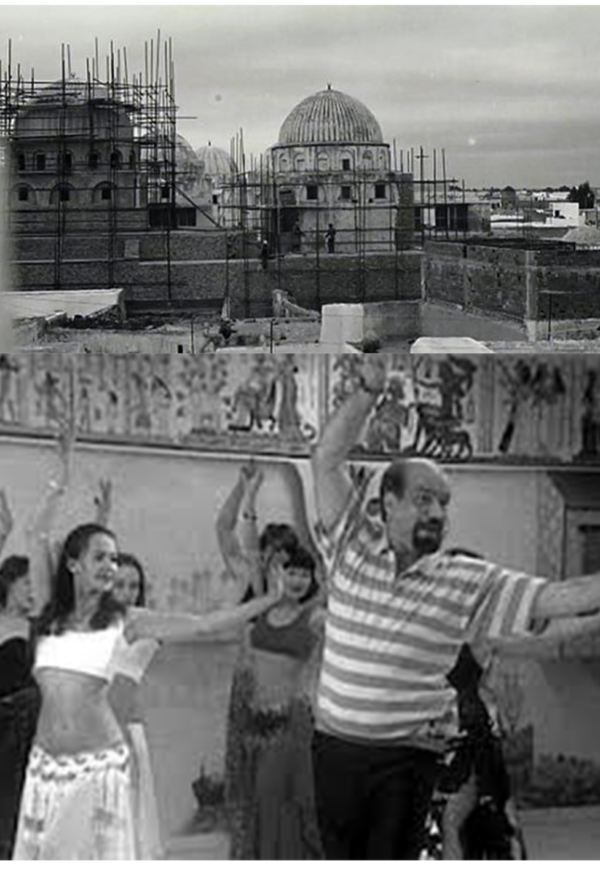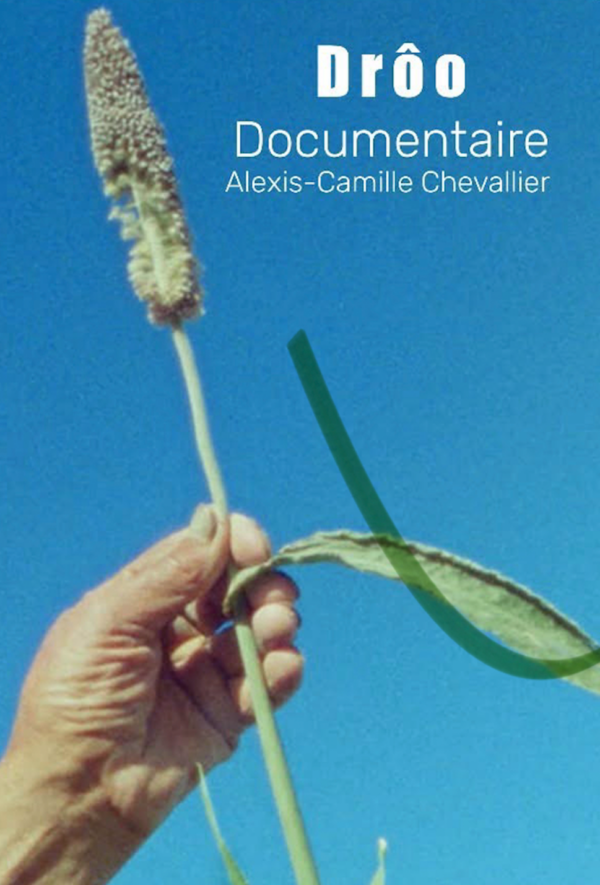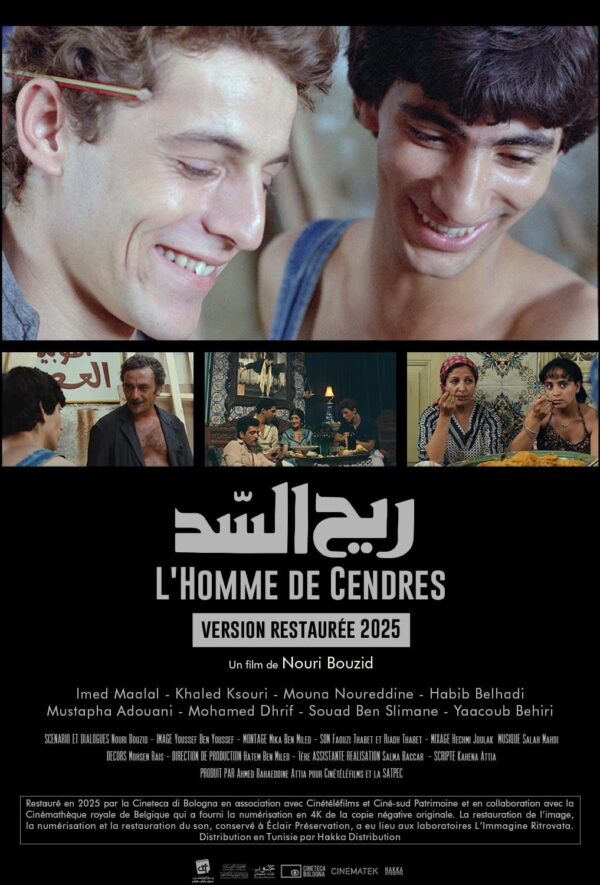Cast & Crew
Derrière le soleil : un documentaire entre introspection et métaphore sociale

Le documentaire Derrière le soleil de Dhia Jerbi s’ouvre sur une promesse intime : celle d’un cinéaste qui tente de comprendre et de dépasser son bégaiement, par peur de le transmettre à son fils. Ce point de départ, d’une grande fragilité, semble annoncer une enquête sur l’origine d’une parole empêchée. Pourtant, très vite, le film déborde ce cadre thérapeutique pour s’élargir vers la mémoire familiale, l’expérience de l’exil, et, en filigrane, les blocages d’un pays tout entier.
Avec ce film, Jerbi s’inscrit dans le genre du documentaire intime, où l’auteur met sa propre vie au centre du dispositif. Son corps et sa famille deviennent le terrain d’un questionnement plus vaste. Dans la tradition de Jonas Mekas ou d’Agnès Varda, Le vécu personnel s’ouvre et devient une porte d’entrée vers l'universel. Le spectateur est immergé dans des bribes de vie quotidienne, des échanges parfois tendus, parfois tendres, qui tissent une chronique sensible de la Tunisie contemporaine.
Le film se distingue par sa texture visuelle, qui rappelle le Super 8 dans certaines scènes. La granulosité des images et les couleurs chaudes créent une atmosphère intime. Les contrastes marqués et le cadre parfois instable donnent vie à des fragments (éclats de souvenirs et réminiscences de la révolution de 2011) qui deviennent une mémoire vivante. Ces images transforment gestes et instants en poésie visuelle, accentuant la proximité avec le spectateur et un sentiment d’immédiateté. Aujourd’hui encore, nombre de cinéastes du cinéma de l’intime ou de l’auto-documentaire recourent au Super 8, ou à son imitation numérique par filtres, pour suggérer la mémoire ou le souvenir, à l’image de certains films de Jao Moreira Salles (In the Intense Now, 2017) ou de Carla Simón (Alcarràs, 2022 & Las pequeñas cosas, 2016).
Ce documentaire interroge constamment la frontière entre sincérité et artifice. Certaines situations paraissent mises en place ou subtilement manipulées, ce que le réalisateur lui-même ne cache pas. Cette ambivalence soulève une question centrale : jusqu’où peut-on manipuler l’intime pour en faire cinéma ? Là où certains verront une faiblesse, un manque de spontanéité, d’autres y liront au contraire une manière assumée de faire surgir la vérité par la mise en scène.
Le récit, d’abord centré sur la guérison d’un trouble personnel, s’élargit rapidement pour devenir une métaphore politique et sociale. Le bégaiement du réalisateur et ses hésitations reflètent un pays en panne, peinant à se remettre en mouvement. Le film suggère que, comme une parole entravée, la Tunisie post-révolution cherche encore son souffle et sa voix. L’intime et le collectif se rejoignent, révélant que le personnel peut porter la mémoire et les espoirs d’un peuple.
À travers ses proches, Jerbi dresse aussi le portrait d’une génération marquée par le désir de départ. La jeunesse tunisienne est filmée entre désillusion et rêve d’ailleurs. Face à cette fuite des corps et des esprits, le cinéaste tente, lui, de planter des racines, littéralement, et de transmettre une langue et une mémoire à son fils. Le film oscille ainsi entre arrachement et attachement, entre perte et transmission.
Ce film propose un espace de réflexion où se croisent expériences individuelles et enjeux d’un pays en quête de voix et de repères. Il rappelle que le cinéma documentaire a le pouvoir de saisir ce qui échappe aux mots et de donner voix à ce qui reste souvent inaudible. Une œuvre qui continue de résonner bien au-delà de son cadre familial, offrant au spectateur un miroir à la fois personnel et universel.
Fadoua Medallel | Septembre 2025